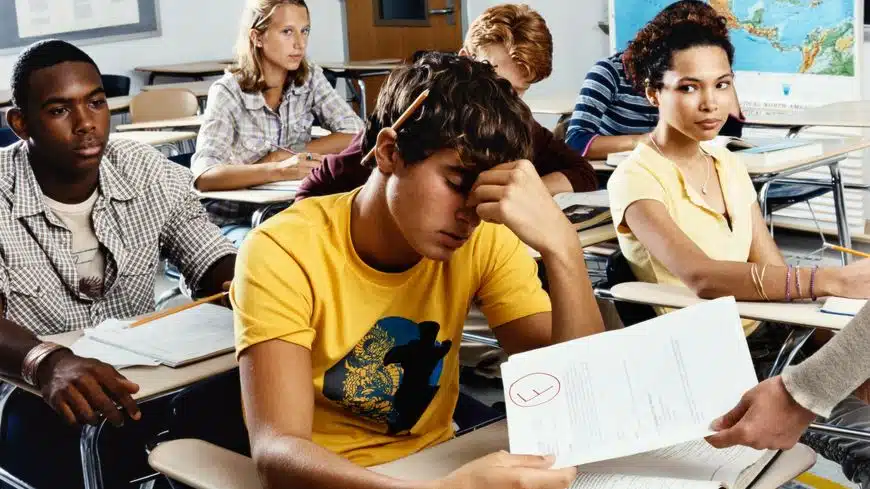Trois décennies séparent la publication du rapport Delors et l’apparition du modèle des quatre piliers, aujourd’hui présents dans la majorité des formations d’enseignants. L’alignement entre recherches en neurosciences et recommandations pédagogiques n’est ni linéaire ni systématique : certaines pratiques traditionnelles s’avèrent validées, d’autres remises en question.
Les publications de Stanislas Dehaene ont bouleversé l’approche de l’apprentissage en France, tout en résonnant avec les fondements posés par Maria Montessori ou Jacques Delors. Des principes considérés marginaux hier sont désormais intégrés à la formation initiale des enseignants.
Pourquoi parle-t-on de “piliers” en éducation aujourd’hui ?
Le terme piliers de l’éducation a émergé sur le devant de la scène dès la publication, en 1996, du rapport de la Commission internationale sur l’éducation pour le XXIe siècle, présidée par Jacques Delors et portée par l’UNESCO. Ce texte, fruit d’une réflexion collective alimentée par des experts venus des quatre coins du monde, a posé un socle inédit pour une éducation de qualité ouverte à tous, alors même que la mondialisation, l’aggravation des inégalités et les défis écologiques bousculaient les repères établis.
L’expression “piliers” n’a rien d’anecdotique. Elle traduit l’idée d’une structure solide, indispensable pour soutenir une éducation de qualité universelle, ambition portée par l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4) des Nations Unies. Ce cadre vise un apprentissage accessible tout au long de la vie, sans discrimination, dans le respect et l’équité. Les quatre piliers se veulent un langage commun, adapté aussi bien aux dynamiques des pays en développement qu’aux réalités des économies les plus avancées.
En s’appuyant sur cette référence, le débat éducatif dépasse les querelles de disciplines. L’éducation se pense alors comme un projet d’ensemble, où savoirs, aptitudes, valeurs et autonomie s’entremêlent. Les piliers deviennent des repères concrets pour guider les politiques scolaires, transformer les programmes et s’attaquer de front aux écarts, notamment dans les pays à revenu faible. Désormais, la question n’est plus “à qui accorder une éducation de qualité ?”, mais “comment la garantir à tous, pour bâtir une société durable et apaisée ?”
Les quatre fondamentaux de l’apprentissage expliqués simplement
Le rapport de Jacques Delors pour l’UNESCO a cristallisé la notion des quatre piliers de l’éducation. Chacun d’eux répond à un besoin humain, indissociable des enjeux d’aujourd’hui.
Voici ce que recouvrent ces quatre axes structurants :
- Apprendre à connaître : il ne s’agit pas seulement de mémoriser des connaissances, mais de comprendre, d’analyser, d’exercer sa pensée critique. Ce pilier valorise l’envie de savoir, le goût de la réflexion, et donne du sens à l’information. On cherche à relier, à interpréter, à construire une compréhension durable.
- Apprendre à faire : ici, l’accent se porte sur les compétences pratiques, l’expérience concrète, la résolution de situations. L’objectif ? Préparer à agir, collaborer, inventer. Les compétences transversales telles que la créativité, la communication et le travail en groupe prennent toute leur ampleur, bien au-delà de la technique pure.
- Apprendre à être : ce pilier touche au développement de la personne, à l’épanouissement, à l’autonomie. Il invite à la prise de responsabilité, à la capacité de choisir, à trouver un équilibre entre logique et émotions. L’individu construit peu à peu son identité, ses valeurs et ses buts.
- Apprendre à vivre ensemble : il s’agit d’apprendre à comprendre autrui, à dialoguer, à respecter la pluralité. Ce pilier cultive la compréhension mutuelle, l’art de gérer les tensions, la solidarité. Il trace la voie vers une citoyenneté active et une société soudée, capable d’accueillir la diversité culturelle.
Renforcer ces quatre piliers, c’est ouvrir la voie à un apprentissage tout au long de la vie, au service d’un développement holistique de chacun. Les compétences acquises débordent largement du cadre scolaire et irriguent tous les parcours, de l’enfance à l’âge adulte.
Neurosciences et pédagogie : ce que nous apprennent Stanislas Dehaene et Jacques Delors
Les découvertes récentes en neurosciences cognitives bouleversent la manière d’enseigner. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, met en lumière quatre leviers majeurs : attention, engagement actif, retour sur l’erreur et consolidation. Ces leviers, issus de la psychologie expérimentale, révèlent la formidable plasticité du cerveau humain. L’enseignant n’est plus un simple transmetteur ; il stimule, interroge, suscite la curiosité et accompagne chaque parcours individuel.
À l’aune de ces travaux, la vision portée par Jacques Delors pour l’UNESCO prend une résonance nouvelle. Le rapport Delors posait déjà comme principe la nécessité d’un développement holistique, où savoirs, aptitudes, épanouissement personnel et compréhension d’autrui s’articulent. Les neurosciences confirment que la pensée critique, la créativité et la coopération ne sont pas de simples options ; elles sont au cœur du processus d’apprentissage.
Cette synergie entre Delors et Dehaene invite à donner tout leur poids aux compétences transversales. Loin d’être un gadget pédagogique, elles deviennent l’ossature d’une éducation de qualité, telle que défendue dans l’Objectif de développement durable 4 des Nations Unies. Apprendre à apprendre, à douter, à dialoguer prend autant d’importance que l’acquisition des connaissances classiques. Désormais, il ne s’agit plus uniquement de transmettre : il s’agit d’armer chacun face à la complexité, d’encourager l’adaptation, de forger l’esprit critique et de préparer les citoyens de demain.
Montessori, pédagogies actives… comment ces piliers s’intègrent dans les approches modernes
Maria Montessori a ouvert la voie à une pédagogie où l’enfant devient le moteur de ses apprentissages. Les quatre piliers de l’éducation, apprendre à connaître, à faire, à être, à vivre ensemble, structurent chaque espace Montessori. L’enseignant, en posture de guide, crée un environnement propice à l’autonomie et à la découverte. L’élève expérimente, manipule, prend des initiatives, développe sa pensée critique et sa capacité à coopérer.
Aujourd’hui, ce socle irrigue un nombre grandissant d’écoles alternatives, mais aussi de classes publiques qui se réinventent. Les compétences transversales, créativité, collaboration, communication, se retrouvent dans les nouveaux programmes, du primaire à la formation continue. Le développement personnel n’est plus un supplément, il est au cœur de tous les parcours, qu’il s’agisse de projets individuels ou de vie collective.
L’Objectif de développement durable 4 (ODD 4) des Nations Unies rappelle que viser une éducation de qualité pour tous, c’est dépasser la simple transmission pour embrasser une démarche globale : acquisition des fondamentaux, inclusion, équité, apprentissage continu. Les défis restent colossaux. Ressources, formation des enseignants, financements, adaptation des méthodes : tout est en jeu. Partout, l’école s’interroge sans relâche : comment tenir ensemble excellence et justice, exigence et bienveillance, innovation et continuité ?
La question reste ouverte, mais une chose est sûre : les quatre piliers ne sont pas près de vaciller. Leur force de cohésion, leur capacité à traverser les réformes et à inspirer les pratiques, en font la colonne vertébrale d’une éducation qui refuse de choisir entre transmission, liberté et humanité.